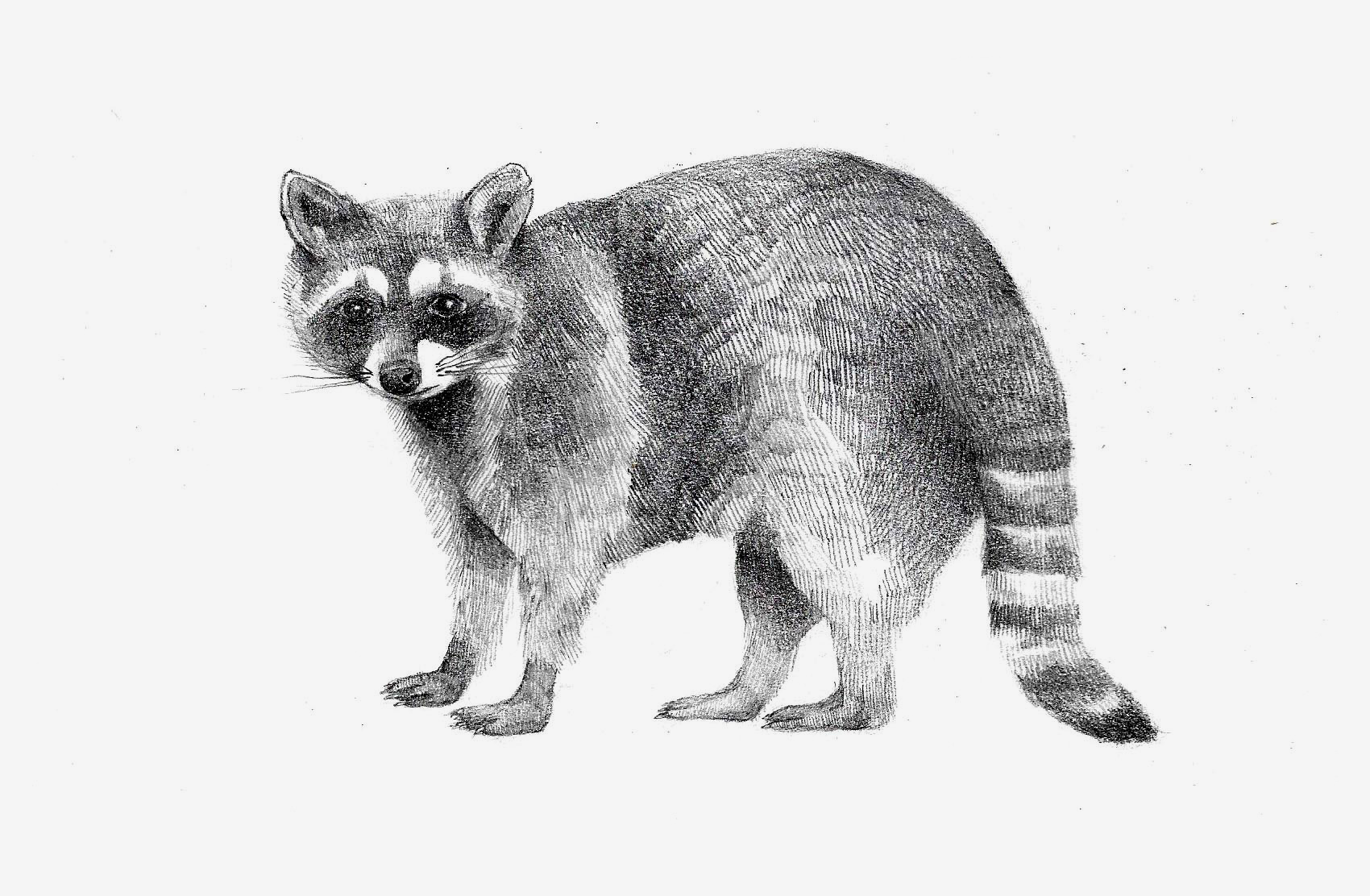
Vir Andres
Which is the closest ski resort to your hometown ?
Claire
I guess it is Vail qui n’était pas très très loin de chez moi à Denver.
Vir Andres
Is Utah also close ?
Claire
Kinda, it is on the other side, they all touch, Colorado, Arizona, New Mexico, Utah touch, it is the same zone.
Vir Andres
Ta tasse, c’est quoi ? C’est la Vendée ?
Claire
Oh, it’s Camargue ! À côté d’Arles, je connais un peu mais pas très bien. Cet été on était là-bas avec ma compagne, je trouvais ce lieu tellement magique, cette plage avec les flamants roses et les chevaux, que je voulais avoir un souvenir un peu rigolo.
Vir Andres
Je sais pas trop par où on pourrait commencer.
Claire
De mon côté j’ai regardé ta conférence, merci beaucoup pour ce partage. J’ai lu aussi le texte.
Vir Andres
Tu as eu le temps de faire tout ça ?
Claire
J’ai fait ça le dernier soir, mais c’est un peu ça nos rythmes de vie, non ? D’ailleurs je suis très content·e parce que je pensais que tu faisais une perf’ le 09 décembre et je n’étais pas certaine d’être là mais si, c’est vendredi prochain et je serai à Paris.
Vir Andres
Je ne connais pas encore les deux autres artistes qui performeront ce soir-là [à Bétonsalon], Soto [Labor] et Nadjim [Bigou-Fathi]. Lotte Arndt m’a invité à écrire un texte, ensuite elle a partagé le texte avec Soto et Nadjim. Apparemment ils se sont inspirés de plusieurs textes dont le mien, La mort du père mestizo, pour faire leurs perf’1. C’est la première fois que quelqu’un travaille autour d’un de mes textes.
Claire
Ça c’est cool non ? J’ai l’impression que c’est un peu l’honneur ultime qu’on peut avoir quand on écrit quelque chose, le fait que ça prend une autre forme, que ça inspire autre chose, c’est trop cool. Et qui est une instance privée en plus.
Vir Andres
Tu seras là vendredi alors ?
Claire
Oui je serai là vendredi, comme ça je pourrai te voir dans un autre contexte.
Vir Andres
Ça peut être intéressant de faire une heure de conversation online aujourd’hui et de prendre un café samedi matin pour faire une partie en « vrai ».

Claire
Oui ! J’essaye de rebondir avec les textes et vidéos que tu m’as envoyés. J’étais curieus·xe de savoir pourquoi tu as traduit ces textes, de cette manière d’aborder la question des situations et des perspectives d’un point de vue historique et esthétique qui était très clair et nécessaire. J’adorerais savoir un peu la procédure de comment vous avez fait les retrouvailles du texte Showing without revealing d’Ashkan Sepahvand.
Vir Andres
Ashkan est un artiste iranien-états-unien qui a participé à l’exposition Qalqalah : plus d’une langue, qui a eu lieu en 2019 à Sète et en 2020 à Mulhouse. Ce sont Virginie Bobin et Victorine Grataloup, commissaires de l’exposition, qui sont d’abord rentrées en contact avec Ashkan. Nous avons décidé de traduire ce texte avec l’équipe éditoriale de Qalqalah قلقلة et l’historienne Mihena Maamouri. Ashkan a été invité à Berlin au Schwules Museum, le musée de l’histoire homosexuelle. Le texte est né de son questionnement autour du fait que cette institution blanche invite un artiste racisé pour parler de cette histoire.
Je me questionne beaucoup sur le poids des mots dans la construction d’un pouvoir symbolique et hégémonique. Par exemple, je ne savais pas que tu étais états-unienne. J’ai été ravi de constater que tu utilises ce terme plutôt que le mot qu’on connaît toutes et tous (américain·e·s), en tant que Mexicain c’est quelque chose qui me touche énormément. Je me posais la question de savoir si dans le lieu où t’as grandi, aux États-unis, il y avait des communautés autochtones ou mexicaines présentes dans l’espace public ?
Ma deuxième question porte sur Kathy Acker, une des écrivaines que tu traduis et que tu étudies depuis quelques années. Je sais qu’elle est décédée au Mexique, à Tijuana, et je voulais savoir si tu pouvais nous en parler davantage sur son passage au sud de la frontière2. Le fait que tu viennes du Colorado, ancien territoire mexicain, encore hanté à mon sens par cette histoire de dépossession, et le fait de la proximité absolue entre nos deux pays, font qu’il y a une espèce de frottement entre les cultures, les épistémologies, les mondes. Au-delà du fait qu’elle a été internée dans une clinique à Tijuana, est-ce qu’elle portait un intérêt particulier au Mexique du point de vue linguistique ou culturel ?
Claire
Ça me plaît beaucoup de parler de ça. Lorsque je vivais aux États-Unis, j’étais tellement aveuglé·e par la culture et le projet impérialiste états-uniens. La façon dont ça se reproduit dans l’éducation, notamment la manière de concevoir la géographie et le langage, jusqu’à en créer une idéologie suprématiste. Je dirais qu’à ce moment-là de ma vie j’avais un manque de capacité et un manque d’outils critiques pour comprendre et pour décrire l’atmosphère dans laquelle j’ai grandi. La capacité même de faire la différence entre les termes américain·e et états- unien·ne est quelque chose que j’ai appris en France.
Lorsque je suis arrivé·e, je sortais de mes études de licence et je me suis retrouvé·e ensuite à Paris VIII en France. Je me souviens d’avoir senti comment mon éducation jusqu’à là était complètement emballée dans un projet d’entreprenariat à l’états-unienne. Je me suis retrouvé·e à Paris VIII parce que je cherchais un lieu où je pouvais faire des études queer à l’époque. J’y ai trouvé un système éducatif moins financé par les grandes entreprises privées, même s’il y a d’autres financements et enjeux dans les universités françaises.
J’ai pu comprendre comment toute ma production et ma façon de produire du savoir dans le contexte des États-Unis était dirigée vers la reproduction néolibérale, je n’étais pas capable de voir cela avant. Juste pour te dire que lorsque j’étais jeune dans le Colorado, j’avais surtout le sentiment de ne pas encore être politisé·e, je suis parti·e à 17 ans. Je me pose un tas de questions afin de comprendre la dislocation qui a eu lieu dans ma vie.

Vir Andres
Je peux comprendre ce que tu dis. Lorsque je suis arrivé en France à 18 ans, j’ai été happé par le même schisme en termes de modèle éducatif. J’ai commencé à réaliser à quel point le système éducatif du Mexique tend à adopter non seulement des mesures politiques et économiques venant des États-Unis, mais aussi à quel point l’influence se retranscrit jusque dans les systèmes pédagogiques. Le système éducatif du Mexique est actuellement une sorte d’hybride entre la France, avec une éducation publique, et le modèle néolibéral et privatisé comme celui des États-Unis. J’ai connu de près cette problématique lorsque j’étais à l’institut technologique de Monterrey, une des universités mexicaines fondées sur le modèle des grands campus états-uniens tels Harvard ou Yale. La manière dont nous abordions l’art ou la philosophie par exemple, contenait une partie explicite de marketing et de vente des savoirs. Au fur et à mesure que le système d’éducation publique mexicain se dégrade et que l’influence des modèles états-uniens s’agrandit, le rêve de nombreuses familles mexicaines est d’offrir à leurs enfants une éducation « à l’américaine ». Un an après mon passage par l’université française, j’ai intégré l’école des Beaux-Arts de Montpellier, expérience qui m’a mis au cœur du modèle si particulier que représentent les écoles d’art françaises.
Je voulais revenir un peu sur les figures de Kathy Acker et de Gloria Anzaldúa, deux femmes qui ont défini la culture queer sur le continent américain. En essayant de faire des liens entre ton histoire personnelle et la mienne, je réfléchis aux chemins, toujours en voie de construction, qui font que l’on développe une conscience politique.
Je me questionne sur l’influence du changement de pays de résidence sur le fait que des figures comme Anzaldúa ou Acker deviennent visibles, est-ce que ce déplacement change notre seuil de visibilité sur les choses ? À mon tour, c’est en France que je suis tombé pour la première fois sur des écrivain·e·s chicano·a·s. Au Mexique, les identités chicanas sont exclues de ce qu’on considère comme faisant partie de la culture mexicaine, cela s’explique par la dissociation entre langue et culture.
Les Mexicain·e·s-américain·e·s et les chican·o·a·s, sont des Mexicain·e·s qui ne se définissent pas uniquement par leur appartenance à la langue espagnole ni non plus par le fait d’habiter à l’intérieur du territoire mexicain national, ce qui déstabilise les idéologies nationalistes des deux côtés de la frontière. Lorsque j’ai commencé à être traversé par la langue française dans ma construction personnelle, émotionnelle et intellectuelle, j’ai trouvé des résonances chez mes frangin·e·s chicano·a·s, j’ai trouvé des pistes d’émancipation qui me sont toujours d’actualité… Bref, tout ce détour pour dire qu’à mon sens il y a toujours un lien entre les divers registres et changements de langue et l’exploration de la sexualité, des choix politiques, chez Gloria [Anzaldúa] et chez Kathy Acker que nous découvrons en France. Je voulais savoir comment chez toi ces textes se traduisent sous des formats poétiques, heuristiques, humoristiques, pédagogiques.

Claire
Lorsque je t’entendais parler j’essayais de me souvenir de la première fois que j’ai lu Anzaldúa — c’était à l’université, ou je faisais des études de genre à l’époque. Une partie des textes qu’on étudiait à cette époque était consacrée aux Chican@ Studies, c’était vu de moins en moins comme une discipline marginale. C’était le contraire de ce qu’on voit en France aujourd’hui, ou afin d’étudier ou d’enseigner certains types de théories féministes considérés comme plus « politicisées », on a toujours besoin d’une tonne de justifications politiques et historiques. J’ai eu la chance de rencontrer plein de gens dans ce cadre des études de genre, qui s’intéressaient à décentrer ce qui était déjà considéré en tant que théories féministes dominantes. On lisait Anzaldúa, et sa multiplicité des langues, comme étant à la fois une piste possible pour construire des avenirs théoriques, et une référence très importante pour faire le travail d’interrogation de la tradition féministe [blanche] en place. Je te parle des années 2006 à 2010.
Je pense que c’est pas anodin qu’on ait tous·tes les deux des pratiques qui utilisent la poétique comme un potentiel émancipateur, comme un potentiel capable de faire surgir les rapports de pouvoir. J’ai beaucoup suivi des textes de manière intuitive qui m’ont guidé·e sur mes choix de vie et sur les directions à prendre.
Anzaldúa, je l’ai lue donc pour la première fois à la fac. Acker c’était une autre histoire : après mes études je suis allé·e à New York, j’avais un stage dans une maison d’édition feministe: The Feminist Press où j’étais parce qu’à l’époque elles étaient en train de changer d’identité et de publier des textes de plus en plus engagés, des textes un peu queer. Lorsque je me suis retrouvé·e stagiaire là-bas, je me disais que c’était un peu mon boulot de rêve, mais bon, à la fin c’était horrible parce que j’étais très peu payé·e. Il y avait un peu cette logique que c’était normal de travailler pour moins que le smic parce que le travail était « important » : il faudrait travailler par l’amour ! Mais quand j’étais là, il y avait une directrice éditoriale qui s’appelait Amy Scholder, qui était juste tellement cool. Elle était une des premières personnes que j’ai vu vivre une vie de meuf gouine, littéraire, à fédérer des gens autour de la littérature, à faire des projets expérimentaux. Elle avait par exemple travaillé avec des textes de Sapphire, mais aussi avec des textes de Kathy Acker3.

À cette époque, je cherchais la moindre excuse pour me rapprocher de sa personne. Alors à une occasion je l’ai abordé·e et je lui ai demandé « qu’est-ce que tu lis ? » comme une façon d’établir une sorte de relation. Et du coup, elle m’a dit : « Je lis Kathy Acker, je vais peut-être faire un projet, une collection de ses textes, est-ce que tu la connais ? » Bien sûr que je la connaissais pas du tout, mais j’ai dit « oui oui bien-sûr » et ce jour là je suis allé·e à la librairie d’occasion à New York, The Strand, the big one, et j’ai pris tout ce qu’il y avait de Kathy Acker. J’ai dû même écrire ça sur un bout de papier pour me souvenir du nom, tout ça parce que je voulais à tout prix rentrer en conversation avec cette éditrice. Ce jour-là au magasin, il y avait deux livres, un qui s’appelle Blood and Guts in High School et un autre qui s’appelle Pussy, King of the Pirates, et c’est drôle parce que rétrospectivement ce sont deux livres qui sont aux opposés de la production de Kathy Acker, un livre de son début et un autre de sa fin. À l’époque, leur lecture m’a paru très difficile, je n’ai rien compris, mais je les ai amenés au bureau, comme ça, pour impressionner cette directrice éditoriale, pour essayer de tisser un lien avec elle, mais ça n’a pas trop bien marché. J’ai appris néanmoins d’autres choses d’elle, par exemple, à l’époque elle était en train de traduire Virginie Despentes ainsi que Testo Junkie de [Paul B.] Preciado depuis le français vers l’anglais, donc ce sont des références que j’ai emportées avec moi quand j’ai débarqué en France.
J’ai quitté les États-unis en amenant ces bagages littéraires que j’avais acquis, par affinité et par envie d’entrer en conversation avec quelqu’un. J’ai enfin essayé de relire ces livres d’Acker après avoir passé quelques années en France, et soudain, ça s’est ouvert à moi, j’ai compris les blagues, elles étaient hyper-drôles, il y avait tellement de blagues sur la construction du savoir, sur l’autorité dans le langage, sur une sorte de langage genré, qui nous est imposé. J’avais besoin de ce contexte, de faire l’expérience de la philosophie telle qu’elle est faite depuis un contexte européen, mais aussi d’avoir du recul par rapport à ce qui ne me plaisait pas du tout dans cette philosophie-là.
Il y avait un extrait dans un livre d’Acker où elle fait une métaphore de la philosophie européenne comme étant en train de mourir, une sorte de cadavre rempli de maggots, de bébé larves, d’asticots. Cette image décrivait ce dont j’étais en train de faire l’expérience en France : d’une sorte d’apparatus de connaissances qui était mort. Je parle d’un type de philosophie normative telle qu’on la trouve souvent dans nos universités [françaises]. Cette transmission qui s’opère depuis un savoir autoritaire qui selon Acker est plein d’asticots. J’ai trouvé quelque chose dans ses livres qui était très très drôle et qui me donnait un sens d’extériorité, un positionnement, une capacité de s’orienter dans une histoire de la production du savoir dans des géographies spécifiques.
S’il y a quelque chose qui me parle toujours chez Acker, c’est cette envie de voir et d’expliciter les traditions de connaissance et comment elles sont liées et construites sur des questions de hiérarchisation géographique. Elle réfléchit toujours sur un rapport de pouvoir qui, pour elle, se situe entre impérialisme états-unien et le colonialisme européen. Son choix d’aller au Mexique, et là j’ai peur de dire des bêtises, mais ce que je peux te dire c’est que c’est peut-être lié au fait qu’à la fin de sa vie, elle allait de plus en plus dans son écriture vers des stratégies de langage qui décentrent la production du savoir. Elle cherchait cette torsion du langage dans les expériences corporelles. Par exemple, elle faisait de la musculation, en anglais it’s bodybuilding…
Vir Andres
Bulking maybe ?

Claire
Oui oui un peu ça, mais c’est un mot spécifique lorsqu’on travaille vraiment les muscles, afin de les pousser jusqu’à l’extrême et d’imaginer le corps comme quelque chose qu’on peut faire muter par ce travail sur les muscles. Elle était en train de faire plein d’expérimentations sur son corps, par rapport à la musculation, par rapport à la masturbation, mais les choses qui pour elle avaient un lien avec des procédures et des protocoles de production langagières et de leur lien avec des contextes politisés. Son intérêt là-dedans l’a menée dans les traitements alternatifs médicaux. À la fin de sa vie, lorsqu’elle était en train de soigner son cancer, elle voulait surtout suivre les traitements éloignés du système standard des États-unis. Elle a cherché des traitements alternatifs, apparemment la clinique où elle est décédée à Tijuana proposait des traitements autres, ça explique un peu ce choix.
Vir Andres
Ça me fait penser un peu aussi au voyage d’Audre Lorde au Mexique, je sais pas si tu as déjà lu ce passage dans Zami, je trouve ça révélateur de la source d’altérité que le passage de la frontière peut représenter :
Parcourir des rues entières peuplées de gens aux visages bruns me faisait un effet profondément exaltant qui ne ressemblait à rien de ce que j’avais connu jusqu’à alors. Des étrangers chaleureux qui me souriaient en passant, regards admiratifs ou interrogateurs, l’impression d’être quelque part où je souhaitais être, que j’avais choisi. […] !Ah, la señorita Morena ! (morena signifie foncée), buenos dias ! […] À cause de la couleur de ma peau et de ma coupe de cheveux, on me demandait fréquemment si j’étais cubaine. […] No, yo estoy de Nueva York. […] Partout où j’allais, des visages dorés de toutes les teintes rencontraient le mien et voir ainsi ma propre couleur de peau réfléchie en si grand nombre de par les rues constituait pour moi une sorte d’affirmation, parfaitement nouvelle et très excitante. Je ne m’étais jamais sentie visible aupa-ravant et ne m’étais même pas aperçue que cela me manquait. 4
Claire
J’étais en train de penser à cette partie de Zami, totalement !
Vir Andres
J’avais une amie française qui était en dépression y’a peut-être cinq ans et en fait j’en ai parlé avec ma mère parce que c’est une amie très proche et ma mère m’a dit « mais pourquoi elle n’irait pas voir une chamane ? » Ma mère s’imagine qu’en France nous avons accès à toutes les ressources de « guérison » alternative qu’on a et qu’on utilise au Mexique. Je vais encore te donner un exemple récurrent dans mon entourage, par exemple, dès que tu as un problème avec une personne qui est en train de throwing shade on you, en train de t’envoyer des mauvaises ondes, et bin, tu les congèles. C’est-à-dire que tu écris un petit message, tu vas le mettre au frigo afin de congeler les bad vibes, j’ai appris à faire ça à mon amoureux qui est français et maintenant il me demande de l’aider à le faire.
Ces rituels magiques sont inscrits dans la vie de tous les jours. J’avais une tante qui avait un lupus, elle est allée à l’hôpital pour se faire soigner pendant quelques années, mais ne trouvant pas de solution à ses maux, elle a commencé à faire appel à la magie. D’abord elle prenait des bains où une guérisseuse venait chez nous (on habitait dans la même maison), la dame égorgeait un coq ou une poule et versait le sang dans on bain pour la faire guérir. Ensuite elle est devenue médium puisqu’un autre médium l’avait convaincu qu’elle avait des pouvoirs. J’ai grandi en faisant partie intégrante de ces rituels où les femmes menaient la danse la plupart du temps. Quand j’ai entendu cette histoire de Kathy Acker au Mexique, je me suis demandé si elle avait pu rencontrer ce genre de pratiques magiques au cours de ce traitement alternatif.

Claire
Il y a eu peut-être cela, mais je n’en ai pas la certitude. Ce que je remarque, c’est un lien entre système médical et système universitaire aux États-Unis, ces deux choses là sont privatisées et sont tellement chères que si tu n’as pas une assurance qui est liée à ton emploi, les soins deviennent hors de prix. Lorsqu’on vient des États-Unis et qu’on se retrouve en France, l’accès aux soins et à l’éducation modifient notre rapport quant à la production de savoir. Je me demande si t’as ressenti l’écart existant entre différentes économies de savoir qui varient d’un pays à un autre, d’un contexte à un autre, accentuées par l’influence du système capitaliste bien sûr. Cela change ce qui est possible de produire dans un lieu de travail, les choix qu’on fait pour déterminer les lieux où on insère ce savoir.
Vir Andres
Ce que tu dis me ramène à nouveau à la frontière mexicano-états-unienne, ou des porosités sont constamment créés, détruites, renégociées, entre des systèmes économiques, des brèches linguistiques, des cosmologies magiques, médicales, des savoirs autochtones et d’autres référencés sur un axe eurocentré. Cela pose la question de qui est soigné et comment, de qui peut avoir recours à des modes de connaissance académiques et non-académiques, et comment.
C’est sur cela que je voudrais me tourner vers le vif de notre conversation, notamment sur le fait que tu es devenu·e enseignant·e à l’école des Beaux-Arts de Nantes. Nous avons toi et moi deux pratiques situées et je me demande avec quels outils tu comptes le faire transparaître. Dans mon cas, depuis deux mois où je suis enseignant à l’école des Beaux-Arts d’Annecy, j’essaie de faire rentrer dans nos discussions avec les élèves les langues maternelles de tous·tes, mais aussi les langues d’adoption. J’ai invité certain·e·s élèves à s’exprimer dans ces langues, et aux autres à accepter la part d’opacité vis-à-vis de la [non]-compréhension, de les inviter à accepter que l’on ne peut pas toujours être la cible de tous les signifiants. J’ai essayé d’être transparent quant au fait que je partage ma vie avec avec un homme et que je me considère une personne queer. Je me pose la question de faire en sorte que ce travail qui passe par l’affirmation de ma subjectivité auprès d’elles et d’eux ne reste pas anecdotique et que chacun puisse à son tour commencer à réfléchir depuis les particularités qui constituent une pratique située. Comment tu fais ?

Claire
Je suis tellement content·e d’avoir cette conversation avec toi et d’apprendre de tes expériences, d’écouter une expérience que nous vivons en même temps, je suis tellement content·e de partager ça avec toi. Ça fait un mois que je suis que je suis prof à Nantes, ce qui veut dire que c’est le tout début. Le fait de rentrer dans l’espace de l’école, de l’institution, me pose beaucoup de questions. Il y a une citation du texte d’Ashkan qui me fait penser aux choix qu’on fait lorsqu’on essaie d’expérimenter avec nos propres pédagogies, l’extrait est vers la fin de votre super trad’ :
En permettant à ces histoires de se déployer, il ne s’agit pas d’offrir une perspective autre—inscrire une autre ligne sur la grille compositionnelle des conceptions du monde. Cela exige un éclatement total des perspectives, un démantèlement d’une vision unifiée, et le reniement du plan pictural en tant que principe d’organisation de la connaissance. Il s’agit de mettre en place une situation où des temporalités multiples de production de l’altérité peuvent occu- per l’espace et proliférer les unes à côté des autres, non-synchronisées et discordantes, non-résolues et complexes, ni faciles à saisir, ni immédiates dans leurs relations.
Toi tu connais bien le texte, donc t’as déjà réfléchi, mais ça m’a questionné·e sur le travail de pédagogie et d’enseignant·e. Il s’agit non seulement de mettre en place des questionnements, des stratégies pour entrer dans les systèmes de représentation tels qu’ils existent actuellement, mais aussi de mettre en question leurs mécanismes de représentation et de comment historiquement ils étaient produits, par qui, comment on entre, avec quel compromis. Comme dit Ashkan, il s’agirait d’éclater les perspectives, de mettre en question totalement les outils qu’on a pour travailler depuis une perspective spécifique.
Dans mon cas, j’essaie de mettre cela en œuvre en utilisant les outils que je connais le mieux, c’est-à-dire les outils langagiers, qui viennent de la poétique, de la poésie expérimentale. Je lutte beaucoup avec cette question de comment éclater les systèmes de représentation qui sont tellement ancrés dans le langage. Comment on peut faire ce travail à la base — sur la forme, la syntaxe, mais pas seulement — à partir de toutes petites unités de langage. Je ne suis pas certain·e d’être arrivé·e à trouver une façon pédagogique de dé-construire ou de faire autrement, mais une chose que je trouve à l’instant intéressante c’est de faire des explorations précises de l’autorité qui est collée dans le système existant afin de comprendre pourquoi certains textes sont tellement centraux dans le système de représentation. C’est-à-dire de regarder des textes existants produits dans des conditions spécifiques afin de tenter de comprendre quels sont les mécanismes qui leur accordent une autorité. Cela s’applique également aux textes produits depuis une altérité, on se demande quelles sont les stratégies qui font que ce texte-là entre dans un dialogue linguistique plus vaste. En décortiquant ces outils-là, on espère pouvoir effectuer non seulement des modifications, mais un éclatement total.
Le texte d’Ashkan parle aussi d’opacité et de la tentative d’assumer l’opacité en tant que quelque chose de désirable, d’abandonner l’idée d’aller toujours vers la clarté du discours. Ces perspectives spécifiques posent un cadre de conversation propice aux moments où ni la compréhension ni la connaissance ne sont parfaites. Elles permettent de faire des chemins de pensée qui semblent un peu opaques sans qu’on sache trop l’expliquer, de jouer avec le langage. Je serais très contente aussi de continuer de t’entendre sur d’autres pistes pédagogiques pour mettre une sorte d’équilibre en place, pour moi c’est une grande recherche, je n’ai pas nécessairement des réponses très claires, mais je mets en place des tentatives.

Vir Andres
Avant de te répondre je voudrais m’attarder un peu sur l’analyse que tu proposes autour des manières dont quelque chose prend de la valeur, dont une forme d’écriture ou un·e auteur·e prend de la valeur. Par exemple, je réfléchissais lorsque tu parlais, en ayant conscience de leurs différences d’écriture, qu’est-ce qui fait qu’un texte de Foucault est codé comme un texte ayant plus de « pouvoir » qu’un texte de Violette Leduc, dans le contexte francophone, ou un texte de Juan Rulfo plus qu’un texte d’Elena Garro dans le contexte hispanophone. J’introduis donc l’idée de Donna Haraway autour de changer son regard et de considérer des textes des écrivaines de science-fiction en tant que documents de savoir, documents philosophiques, documents analysant la psychologie humaine.
Concernant les pistes de pédagogie, j’ai deux petites pistes. La première est une piste pratique liée à une connaissance théorique : je me suis aperçu que mes étudiant·e·s n’ont pas de cours à proprement parler autour du montage vidéo ni d’assemblage d’images. Je considère que cette connaissance a été précieuse et a marqué mon regard, c’est mon ancienne enseignante Caroline Boucher qui a passé d’innombrables heures à essayer de faire en sorte qu’on écoute » nos images, qu’on apprenne à en faire un montage. Aujourd’hui, je mets cette transmission en relation avec le concept de listening to images de Tina Campt, qui est aussi une de nos inspirations chez Qalqalah قلقلة :
Écouter des images désigne le fait de recalibrer des photographies vernaculaires, c’est une pratique silencieuse qui nous donne accès à des registres affectifs à travers lesquels les images énoncent des récits alternatifs de leurs sujets. […] Écouter des images affirme que le calme ne doit pas être confondu avec le silence. Le calme s’enregistre sur le plan sonore, comme un niveau d’intensité qui nécessite une attention particulière. De manière analogue, la photographie silencieuse nomme une heuristique pour s’occuper de la gamme inférieure d’intensités générées par des images supposées muettes. Le choix d’écouter plutôt que de simplement regarder les images est une décision consciente de remettre en question l’équation de la vision avec la connaissance en engageant la photographie à travers un registre sensoriel essentiel aux formations culturelles noires diasporiques : le son. [Ma traduction]5
Je mets une bonne partie de mon énergie et de mon temps à écouter les images de mes étudiant·e·s en leur présence, particulièrement pour celleux qui font des images photographiques et des images en mouvement. Il n’y a rien de plus frustrant qu’un·e enseignant·e qui ne prend pas le temps d’écouter ce calme déjà-là dans l’image. Si nous ne nous arrêtons pas pour écouter et monter nos images en fonction de ce qu’elles nous racontent, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que leur mystère attire un·e regardeur·euse, même si leur attirance ne dépend pas de ce seul fait bien sûr. Je suis facilement touché par l’image en mouvement, même un début de montage, ou un film avec un son catastrophique peuvent me toucher, je suis toujours heureux de découvrir un film en train de se faire. S’entraîner à écouter des images n’est pas en lien avec une qualité d’image apportée par une prouesse technologique, ni non plus à un attachement envers l’harmonie ou la beauté de l’image. Je considère à mon tour qu’écouter une image implique de trouver des possibilités d’inclure et de trouver de la justesse dans des images ratées, des images « vulgaires », des images inattendues, des images « gnangnan », des images « pauvres »6, des images intimes qui sans le vouloir racontent un exode, qui désignent une multiplicité de chemins.
La deuxième piste pédagogique est en lien avec le fait d’ouvrir la porte de la salle de cours et d’accueillir les langues et les cultures de tous·tes les étudiant·e·s. Cela peut paraître une bonne proposition, le fait d’inclure, mais dans la pratique, cela pose des problématiques très rapidement. Par exemple, j’ai trois étudiantes coréennes, l’une d’entre elles a présenté son travail d’abord en français et ensuite, à ma demande, en coréen. Ce fut assez libérateur pour elle, puisqu’on a entendu son parler sans les difficultés ou les éventuelles lacunes qu’elle peut avoir en français. Le fait que la classe ait entendu d’abord une explication en français a aussi libéré l’écoute en coréen qu’elle a fait ensuite. Nous ne nous attendions pas à comprendre le sens des mots, pour la plupart c’était une découverte de la sonorité du coréen.
Alors que pour cette étudiante (Yuhyeon), le fait de parler coréen l’a « empouvoirée » vis-à-vis de la classe, ma deuxième étudiante coréenne est venue me parler pour me dire qu’elle ne voulait plus parler le coréen, qu’elle préférait le faire seulement en français même si elle avait de la difficulté. Cela m’a fait réfléchir sur cette évidence que représente le passé de chacun. Des fois on peut avoir vécu des violences, une histoire qu’on essaye d’oublier, un poids dont on essaye de se détacher. La langue maternelle cristallise toutes ces choses-là. Le fait d’ouvrir la porte pour faire en sorte que les cultures et les langues de toustes entrent dans la salle est à double tranchant, c’est une boîte de Pandore.
Il faut faire attention en tant qu’enseignant·e de ne pas demander aux étudiant·e·s de rejouer quelque chose de traumatisant, de rejouer une violence, par le biais de la langue ou autre. Mais en même temps, il faut savoir donner des outils à ceux et celles qui souhaitent travailler avec leurs vécus et leurs histoires personnelles, afin de leur permettre de recycler toute l’énergie que ce type de travail nécessite, de leur permettre de trouver des manières de se protéger. C’est complexe mais je sais que de faire le contraire, à savoir, prendre pour acquis que notre seul outil de communication est la langue française, revient à clore maintes possibilités pédagogiques et plastiques.

Claire
C’est très intéressant. Lorsqu’on a fait des études dans plusieurs pays et espaces linguistiques on peut remarquer que ces signes et marques d’autorité changent selon le contexte.
Je reviens sur ces codes de formation de l’autorité. Comme je le disais, le fait d’avoir été formée à l’université et non pas en école d’art, m’a confrontée à d’énormes enjeux hiérarchiques et des façons de parler qu’on pourrait qualifier d’« autoritaires ». Par exemple, la manière dont nous prenons la parole en France dans l’enseignement demeure très autoritaire à mon sens, et cela correspond à une structure tout à fait différente de celle qu’on va voir sur un TedTalk, pour donner un exemple de la tradition états-unienne.
Dans les écoles d’art en France il me semble qu’il y a des jeux de hiérarchie et d’autorité particuliers et qui entrent en jeu dans ces moments d’écoute et de prise de parole. Comment est-ce qu’on installe ces moments d’écoute ? Comment est-ce que le champ commun peut être investi de tout ce qu’amènent les différent·e·s étudiant·e·s ?
J’adore ton exemple où tu amènes ces différents types de langage et de langue afin de tenter d’éclater les cadres. Il y avait un truc que tu as dit dans ta conférence au Mucem à Marseille, c’était l’idée que certaines langues avaient pris en otage d’autres langues, d’autres connaissances, j’ai adoré cette idée. Peut être que je suis en train de manipuler un peu tes mots, mais il y avait l’idée qu’en changeant de contexte linguistique, ou en naviguant à l’intérieur d’un contexte multilinguistique, on peut apercevoir et faire appel à des codes et des informations jusque-là cachées, prises en otage par la langue kidnappeuse. Pour moi, tous ces codes autoritaires détiennent eux aussi en otage certains positionnements linguistiques, surtout si on imagine qu’il y a une seule façon « correcte » ou convenue de s’exprimer. Ceci est accentué lorsqu’on évolue dans le continuum d’une atmosphère monolinguistique.
Vir Andres
Je me questionne aussi sur ce que représentent l’anglais et l’espagnol, nos deux langues maternelles donc, au sein de l’école d’art française. Dans un monde de l’art européen et occidental, on considère l’anglais comme langue de facto pour communiquer. « On » stimule son utilisation et sa compréhension afin d’intégrer les milieux professionnels des arts. Je dis « on » parce que je m’inclus dedans, lorsque je partage un bout de texte en anglais, j’essaie d’être conscient de ce que cela implique pour des étudiant·e·s n’ayant pas une maitrise totale de cette langue, d’y être exposé·e·s. Ceci dit, l’anglais « impose » un rapport de domination culturel et d’autorité tel que je trouve important de commencer à le décortiquer et à le déconstruire. Par exemple, j’ai demandé à deux de mes étudiantes latinxs de lire un texte de Carmen Boullosa et un autre de Borges d’abord en espagnol puis en français.
J’ai aperçu et je continue d’apercevoir chez mes étudiant·e·s, une différence de réception dans l’écoute de l’anglais par rapport à l’écoute de l’espagnol qu’on n’associe pas en premier lieu à la sphère de l’art contemporain. Je dis ça en ayant conscience que l’espagnol est aussi une langue impérialiste. L’espagnol, autant que l’anglais et le français, sont des entités tortionnaires. Cependant, c’est comme si on avait intégré le fait que lorsqu’on entend une information en lien avec l’art en anglais, cela méritait le fait qu’on s’y attarde. Ces écarts dans la prédisposition de l’écoute continuent de m’interroger. Je voulais savoir comment est-ce que tu te situes par rapport au fait d’être un·e enseignant·e anglophone.

Claire
C’est vrai qu’il y a un énorme équilibre toujours que j’essaie de trouver, trouver les choses qui peuvent être utiles provenant d’un contexte états-unien. On parle un petit peu du fait qu’il y a certaines productions de savoir antiracistes et queer qui sont intéressantes de déplacer de leur langue anglaise de production et d’amener au sein de la langue française. Je fais attention en sorte de ne pas présenter ça comme étant la seule histoire possible. Quand je constitue les bibliographies, j’essaie d’être conscient·e du langage dans lequel les textes sont écrits et produits. Par exemple, si je prends un texte écrit dans un contexte anglophone des années 70, j’essaie de mettre un texte francophone qui réponde en quelque sorte au premier contexte. Je pense que la traduction est un mécanisme important pour produire la capacité de désirer bouger entre les langues, de chercher des connaissances se trouvant « avalées » par d’autres langues.
J’essaie de désacraliser l’approche envers des textes en d’autres langues que le français, afin de donner envie d’aller chercher ailleurs, et de pouvoir affronter l’incertitude qu’on peut avoir quand on est face à un texte difficile d’accès par son niveau de langage ou par l’incompréhension de la langue. Je pense par exemple à la manière dont tu parlais de Sor Juana Inès de la Cruz dans ta conférence. Je la connaissais puisqu’elle est une icône pop et lesbienne, même si c’est un personnage ancien.
Vir Andres
J’ai un travail de recherche autour de Sor Juana et d’autres figures féminines religieuses du baroque et du Moyen-Âge. Il y avait peu de femmes écrivaines mais beaucoup de traductrices. Il y avait peu de femmes écrivaines mais beaucoup de religieuses « possédées ». Cela me fait penser à la traduction en tant qu’acte queer et feministe. C’est un peu tiré par les cheveux et il va falloir que je me penche davantage sur la question mais tout est parti d’un texte de Michel de Certeau autour des possédées de Loudun. Il essaye d’apporter une nouvelle interprétation de tous ces documents du passé lorsqu’on essaye de les approcher en utilisant des questionnements qui sont ceux de la « performance » telle qu’on la connaît aujourd’hui. Et bien il y a aussi la réflexion autour de la réinterprétation des textes sacrés que ces femmes religieuses faisaient depuis le latin et le grec vers le bas-allemand, l’ancien français, le provençal et tant d’autres langues dites « vulgaires ». Cela redéfinit la notion d’auteur·rice, repositionne la traductrice au sein de la production de savoir et place la pratique de la traduction comme un « médium » artistique à part entière. Une « traductrice » des temps actuels est Carmen Boullosa qui « réécrit » le livre de la genèse depuis le point de vue d’Ève, de ses filles, de ses petites filles et de nombreuses femmes religieuses telle Thérèse d’Avila7. Est-ce qu’on pourrait imaginer que la traduction nous sert à queerer l’histoire ?

Claire
Ouais ! Quand je fais des traductions on peut tomber souvent dans une espèce de rigidité au moment du choix de certains mots. Je pense au mandat de you know faire rentrer une traduction dans le canon standard de l’édition française. Lorsqu’on propose des traductions « libres » on nous rétorque : « cela ne se fait absolument pas » ou alors : « ça n’existe pas, ce n’est pas possible ». Il y a maintes formes de rigidité qu’on rencontre très rapidement lorsqu’on fait l’exercice de la traduction. Ceci est révélateur de certaines différences entre des contextes linguistiques qui laissent apparaître les édifices impériaux sur lesquels résident les discours. J’adore imaginer des traductions qui ne sont pas très exactes, tu sais, des traductions un peu « erronées ».
On se rend compte que lorsqu’on veut traduire depuis l’anglais vers le français, on a des propositions qu’on souhaite faire mais qui n’existent pas grammaticalement. En anglais y’a plein de verbes qui peuvent être construits depuis des substantifs, en français il y a plein de verbes qui ne peuvent pas être modifiés en substantif. J’essaie de prendre cette inventivité de la langue anglaise et de proposer des mots en français. Pour être plus claire je te donne un exemple : cette année, nous traduisons la poète Lisa Robertson depuis l’anglais vers le français avec Sabrina Soyer. Nous trouvions qu’il y avait une énergie « gouine » qu’il n’était pas possible de faire paraître dans un français standard.
Une chose précise qu’on a faite lorsqu’on se retrouvait avec Lisa pour regarder ensemble notre traduction consistait à regarder les mots qui ne marchaient pas dans la version française. Plutôt que de chercher cliniquement le terme ou la traduction exacte, on s’appliquait à essayer de piocher des mots se trouvant dans d’autres livres écrits dans un registre « sympathique ». La méthode consiste à mettre son doigt au-dessus d’un mot jusqu’à en trouver un et se dire: « tiens ! c’est ce mot qu’il faut utiliser. » Ainsi nous ne nous attendions plus à trouver la corrélation correcte des mots, mais plutôt par sympathie de registre.
Ces mots-là venaient ainsi d’une source corollaire, servant de dépositoire de matériel vocabulaire pour la traduction qu’on était en train d’élaborer. Il y a plein d’exercices comme celui-là qui ouvrent les champs de ce qui peut être la traduction, dans ce cas la traduction gouine.

Vir Andres
Ce que tu dis me renvoie à mon film Misurgia Sisitlallan, que tu as pu regarder. Ce film est en partie narré en nahuatl, il raconte entre autres des histoires de la vie et des mœurs des personnes qu’aujourd’hui on considèrerait LGBT et non-binaires, des personnes habitant dans le Mexique précolombien. Pour moi c’était important de le raconter en nahuatl et que le message reste incompris (à première vue / écoute) par ceux et celles qui communiquent uniquement dans des langues impériales. Or, même si je trouvais que les parties de la narration en espagnol, en français et en anglais étaient nécessaires, je cherchais une manière de « détruire » leur intelligibilité, de diminuer leur imposition. Une minute de nahuatl n’est pas perçue comme une minute de français. Entre temps, j’ai regardé le film Storytelling for Earthly Survival8 où Donna Haraway dit : « To balance our earthly living, weak stories are to be rendered strong while dominant stories to be rendered weak. »
Je réfléchis désormais à comment je peux transformer cette narration en une forme performée que je suis invité à présenter à la Gaîté lyrique en mars 20229. Dès lors qu’on prononce un mot en espagnol, en anglais ou en français, on a l’impression qu’il y a « sens », alors je me pose la question de leur accorder une présence par leur « sonorité » et non pas par leur sens. Tandis que le nahuatl, qui demeurera toujours incompréhensible par les non nahuaparlant·e·s, sera toujours porteur de sens et de sonorité. Pour toi, quel est le rôle de la parole dans tes performances ? Par exemple celle du texte My construct (a cunt) à laquelle Virginie Bobin, de Qalqalah قلقلة, a assisté et qui par ailleurs a confirmé notre envie de rentrer en conversation avec toi.

Claire
Ce texte est en train d’être édité dans le cadre d’un livre qui sera bientôt publié, il a été d’abord présenté dans le cadre d’un symposium appelé Kathy Acker: Get Rid of Meaning à la Badischer Kunstverein à Karlsruhe en Allemagne. Ils ont fait le choix de publier ce texte avec des annotations et des documents manuscrits. Les manuscrits sont le lieu par excellence de l’incertitude : s’y trouvent des choses barrées, non maîtrisées. Toutes ces choses-là seront présentées avec le texte.
J’adore ce que tu disais par rapport au fait que les langues peuvent être surchargées, et comment il peut y avoir une sorte de sur-sens donné à des mots dans des contextes spécifiques. Je trouve ça très parlant que tu souhaites aller vers la performance avec ton projet. Je me sens très interpellé·e par la forme de la performance, qui est souvent liée à l’insuffisance parfois de certains textes ou des modalités d’éditions qui existent pour le travail textuel. Si on est écrivain·e on est coincé·e avec l’idée de performance littéraire, c’est-à-dire une personne devant un podium qui lit un texte sans trop l’interpréter.
Il y a plein de codes qui sont mis en place pour valoriser le statut écrit des choses. Il me semble qu’on est beaucoup à se poser cette question de comment ouvrir un espace pour l’intervention textuelle ou pour les pratiques textuelles qui se dirigent vers la performance. Je me souviens de l’événement à la clairière de Vincennes, qui accueillit autrefois l’université détruite, et que Virginie [Bobin] avait organisé. Tout était fait par rapport à un parcours, il y avait des présentations de travail à des points géographiques spécifiques dans le parc de Vincennes, en lisant les textes dans ce périple là nous cherchions à expliciter les sortes de couches d’histoire se trouvant dans ce lieu-là. Mais aussi like l’acte de bouger provoquait un effet sur la compréhension des textes. On a pu être très attentif·ve·s aux opérations d’orientation géographique et savoir qui est dans chaque texte.
Tout cela est lié au travail que nous avons réalisé ces dernières années avec un collectif queer, gouine et non-binaire dont je fais partie et qui s’appelle RER Q, nous sommes six : Rébecca Chaillon, Camille Cornu, Wendy Delorme, Élodie Petit, etaïnn zwer et moi. Nous avions privilégié le format de lecture en public pour les textes que nous produisions ensemble, des textes destinés à être performés.
Vir Andres
Je profite de notre halte au bord du RER Q pour te partager un souvenir. Quand j’avais genre douze ans et que j’étais au Mexique rêvant de me rendre en France, je communiquais avec d’autres personnes sur la plateforme last.fm, qui te permet de rentrer en contact avec des personnes qui écoutaient des musiques similaires. Un des cyber-ami·e·s avec qui je communiquais était Marguerin le Louvier, que j’ai pu rencontrer en vrai il y a quelques années.

Claire
Oh my god ! C’est excellent ! J’ai découvert Marguerin dans un atelier où il y avait des groupes de lecture. Quelqu’un·e avait amené un texte de lui, un texte mystérieux imprimé sur des feuilles détachées sans d’autres informations. C’était le genre de texte que tu lisais et immédiatement tu avais besoin de savoir qui était celui ou celle qui l’avait écrit ? D’où venait-il ? Tu avais envie de retrouver le reste.
Pour revenir à RER Q, on s’est retrouvé·e·s dans le désir de vouloir explorer les représentations de sexe explicite queer, non binaires et gouines. On a commencé par faire une performance de manière accidentelle. Il y avait quelque chose avec le fait de transformer le texte en performance, cela concerne notamment les textes qui parlent du sexe de manière parfois pornographique, il y avait quelque chose qui semblait très vital, c’est le fait d’amener ces textes dans un lieu public et dans un espace de performance.
On a tous·tes des sentiments différents sur le pourquoi on faisait ça. De ma part, quand on est gouine ou fem on a tendance à imaginer que tout ce qu’on dit c’est toi, qu’il y a une incapacité à raconter quelque chose qui n’est pas soi-même. Il y a une incapacité à raconter des expériences physiques sans être ramené·e tout de suite à notre expérience physique, à notre corps. On ne laisse pas imaginer que ça peut être d’autres corps ou d’autres expériences. De se retrouver dans l’espace de la performance vient marquer l’absence de matériel performé explicitement queer pornographique littéraire, mais aussi de vouloir jouer avec le fait qu’il y a une grande pression de vouloir identifier la personne queer associée à ces récits-là.
Vir Andres
Dans le texte que j’ai partagé avec toi, l’écrivaine autochtone mexicaine Yasnaya Aguilar se questionne sur le fait que Bob Dylan ait reçu le prix Nobel de littérature, pour elle c’est un grand pas vers la déconstruction de l’idée que l’écriture est le seul moyen pour figer une idée poétique, elle évoque que la parole peut aussi être le lieu de cette énonciation :
Tant de détours, tant de siècles pour enfin conclure ce qui était là au début, à savoir que la fonction poétique du langage en Occident est née en même temps que la musique de manière indissoluble. Il ne faut donc pas oublier que la poésie était plus de la musique que de l’écriture lorsqu’elle est née. Il ne faut pas oublier que la littérature est seulement une parmi des nombreuses manifestations de la fonction universelle du langage : la fonction poétique. les formes poétiques n’ont pas toutes besoin d’une écriture. Imaginez-vous qu’un jour une communauté de locuteurs·rices reçoive le prix Nobel de littérature grâce à leur tradition poétique orale ? Le prix ne s’appellerait plus Prix Nobel de littérature, mais plutôt prix Nobel de la fonction poétique des langues du monde; en attribuant ce prix à Dylan (bob), ielles ont fait un petit pas vers cette transformation10.

Claire
Ça me fait penser qu’un des choix qu’on a essayé de mettre en place avec RER Q consistait en des lectures/ performances dans les bars et dans les lieux queer, dans des sex-parties par exemple. Cela faisait partie du contexte dans lequel la capacité poétique était produite. C’était important de présenter cette matière-là dans l’espace de ces fêtes queer et gouines.
Vir Andres
Sur ce coup, je pense que vous gouines et fems avez une grande longueur d’avance par rapport à la culture gay-pédé masculine. Le fait d’intégrer la parole et l’écoute dans ces lieux en est la preuve. Je voudrais imaginer des lectures de textes poétiques au sein d’un lieu de sex-party comme Le dépôt à Paris, ou autre.
Claire
C’est vrai que nos espaces sont bien plus hétérogènes !
Vir Andres
Les revendications gays masculines ont été avalées par des rêves de capitalisme, de consommation, de virilité et de masculinité toxique. C’est d’ailleurs une de mes communautés dans laquelle je ne trouve pas vraiment mon compte. Nous avons beaucoup à apprendre des gouines, nous avons besoin de réintroduire l’écoute, le langage poétique dans nos échanges entre mecs pédé, mais bon, là on rentre dans un autre sujet !
Claire
Je pense qu’avec les codes pornographiques et érotiques queer, gouine et non-binaire, j’avais d’abord besoin de décrire le sexe puisque ces récits semblaient être absents en français, à ce moment-là. Mais ensuite j’ai eu une frustration avec la façon dont le sexe est souvent presenté selon une même idée de sexiness, une même idée du plaisir qu’on est censé·e avoir des mêmes actes qu’on voit répétés. Maybe c’est le moment de décrire du sexe compliqué, du « mauvais sexe » ? Mais il y aussi d’autres expériences que le désir et le sexe qui peuvent nous aider à obtenir une émancipation, des moments ou l’on se sent pas conforme aux normes de beauté ou de sexualité qui sont dominantes y compris dans nos communautés. Il y a une capacité d’intervenir en performant des moments intimes. Par exemple, le moment où un lavement anal s’est mal passé : des moments qu’on a tous·tes vécu mais dont il n’existe pas de matière textuelle.

Vir Andres
Il y a peut être un lien entre lavement anal et pédagogie, haha ! Il y a quelques mois je faisais une exposition avec un groupe d’artistes dont la majorité était hétéro, hommes et femmes confondu·e·s. Un des artistes, Victor Villafagne, racontait qu’il aimait expérimenter avec son corps et effectuer des lavements. Tout le monde a éclaté de rire mais je l’ai secondé en disant que pour nous, faire des lavements équivalait à acheter un pain au chocolat (chocolatine ?!). Par là je veux dire que malgré tous les droits obtenus, malgré une grande ou petite représentation dans les médias, nous, personnes queer et LGBT, continuons de traverser des problématiques spécifiques selon si on vit à la campagne ou à la ville, selon le milieu social, le contexte national, etc. Il y a des discordances qui créent une multiplicité de temporalités dans les luttes et qui libèrent, ou pas, la parole.
Claire
Il y a un énorme lien à faire, j’ai été frappé·e quand j’ai commencé à enseigner dans la fac d’études de genre, par la manière dont les choses que j’ai eu énormément de mal à acquérir étaient tellement facilement acquises par les étudiante·s. C’était tellement fort de constater leur usage d’un langage politiquement engagé que je ne me rappelle pas avoir eu à leur âge. J’ai eu la conscience de vivre au milieu d’une myriade de couches de réalités et d’expériences queer qui me rappelaient notre place dans l’institution qui à son tour est une sorte de mille-feuille avec des strates de connaissances très anciennes, toujours actives. Je trouvais cette superposition intéressante, ça décrit très bien l’endroit à partir duquel je pense être en train de parler, je me vois à l’intérieur d’une de ces strates de temps et de parole et je suis entourée de temporalités queer et feministes de natures differentes qui s’interposent.
Vir Andres
Ça revient à l’image du gâteau dans cette vidéo où Donna Haraway parle de la revue The National Geographic on Primates : « to take a layer cake and cut in the history as if it were a layer cake and begin to unpack the layers of meanings. Unpack the layers of meanings of all of the pleasures and all of the problems that these layers of meanings produce. »
Merci Claire pour cette balade entre opacités, celle de Glissant, celle d’Ashkan, celle de notre traduction chez Qalqalah قلقلة, parmi les multiples temporalités évoquées par Anzaldúa. Je dois te quitter.
Claire
On se retrouve à Paris dans deux jours !
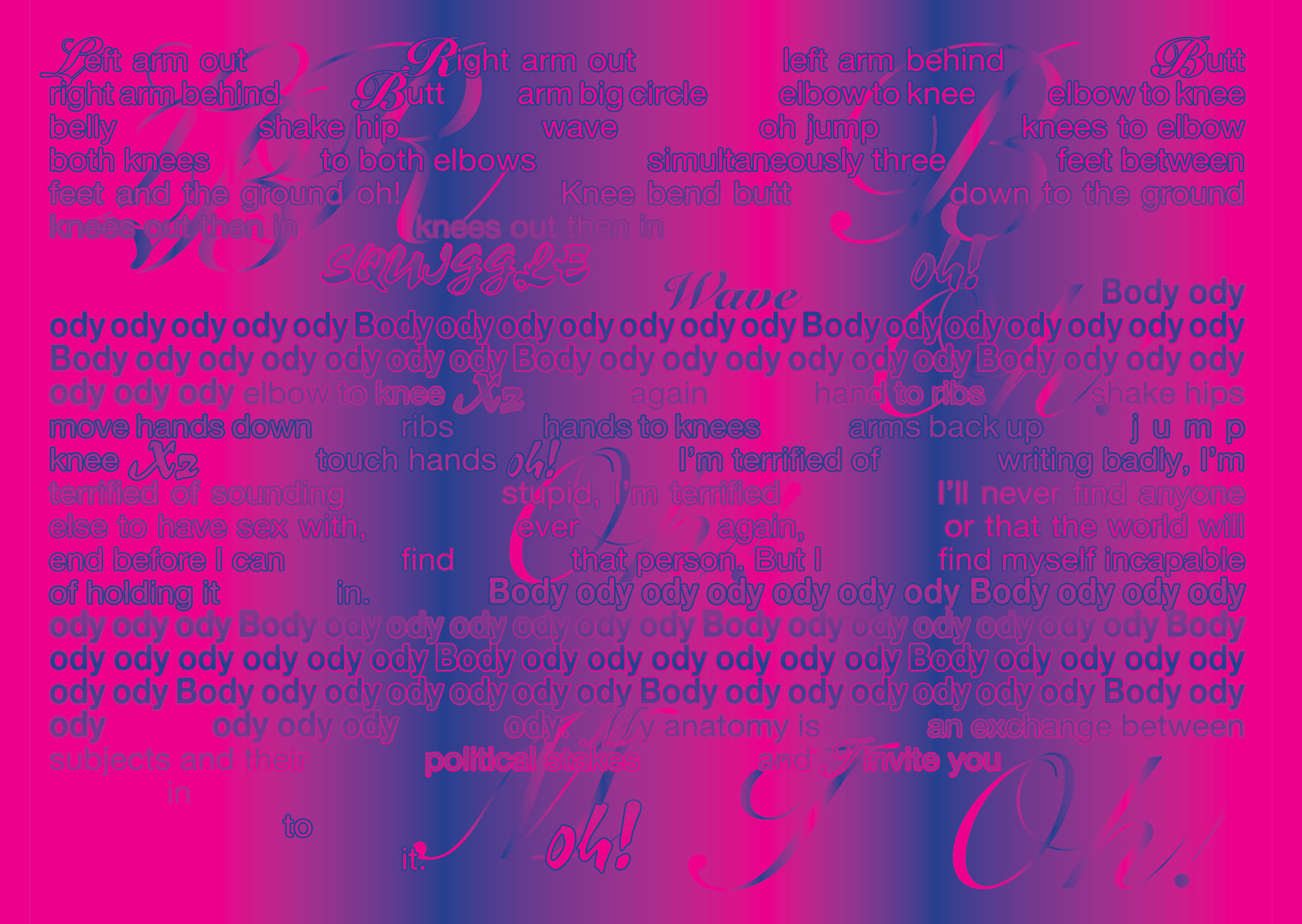
Note des éditeur·ices:
Les images présentées dans cette conversation ont sélectionnées par Vir Andres Hera et ont été publiées sur l’édition imprimée #6 de HOOT. Il s’agit des œuvres d’artistes et d’ami·e·s qui accompagnent et nourrissent les réflexions ici évoquées.